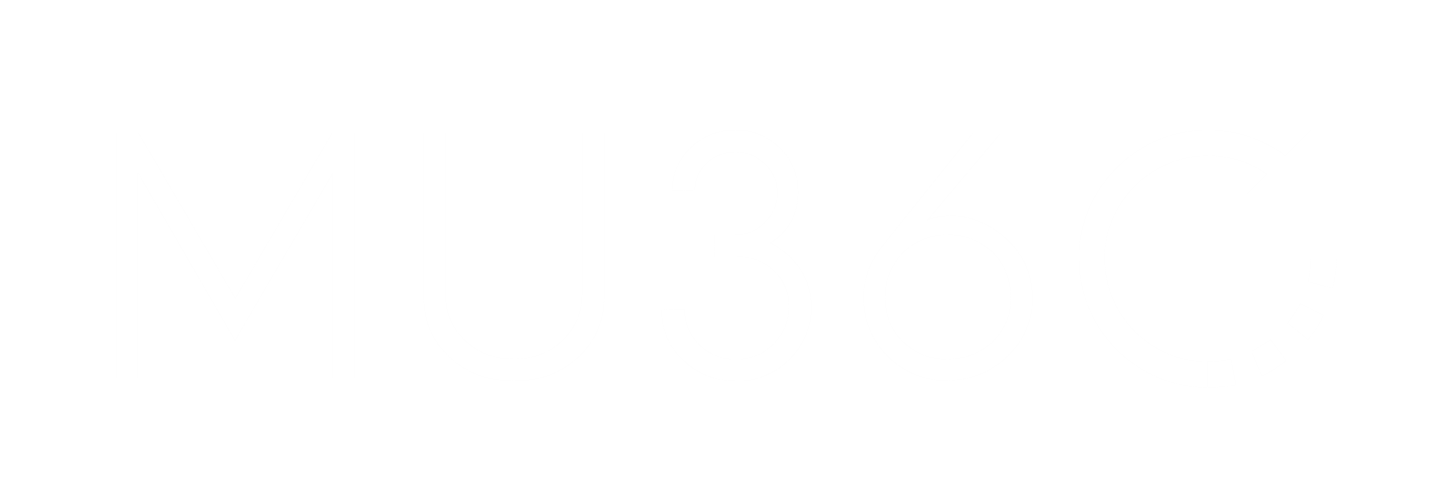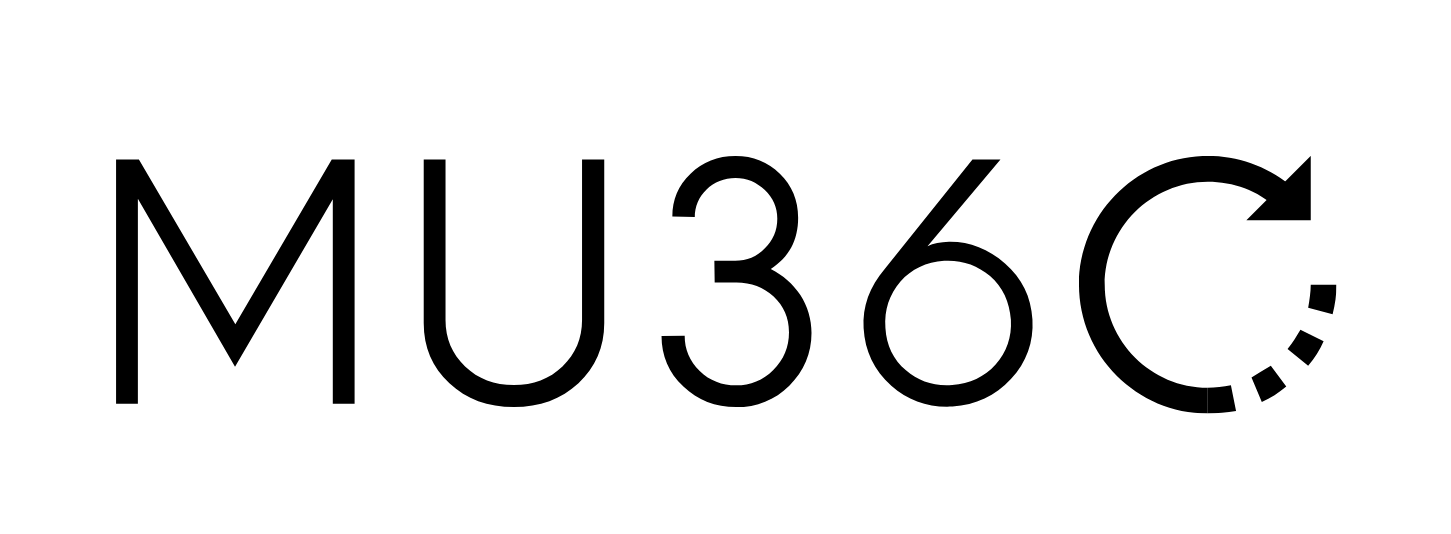Au Québec, plus d’un jeune sur trois issu de la protection de la jeunesse sera en situation d’itinérance avant ses 21 ans1. Cette statistique souligne une faille majeure : la transition à la vie adulte est un moment de grande vulnérabilité. Pour éviter que ces jeunes ne se retrouvent à la rue, il faut intervenir en amont.
C’est justement à la prévention que s’intéresse le projet de recherche-action participative jeunesse mené par Sue-Ann MacDonald du CREMIS, en collaboration avec la Coalition Jeunes+ ainsi que des acteurs et actrices du milieu communautaire. Son constat est clair : la clé de la prévention réside dans les liens sociaux.
Répondre aux crises personnelles
Les jeunes en situation de grande précarité vivent souvent un cumul de ruptures sociales, que ce soit dans les services qu’ils fréquentent, les institutions qui les encadrent ou encore l’entourage familial. Selon Sue-Ann MacDonald, ces jeunes sont confrontés à trois types de crises qui s’entrecroisent et influencent leur trajectoire.
La première est une crise de connexion avec des adultes significatifs. Le roulement du personnel et le manque d’effectifs nuisent à l’établissement de relations stables et durables. Une approche plus souple, comme la présence accrue de travailleurs et travailleuses de rue en milieu scolaire, pourrait faciliter la
création de liens significatifs et réduire le risque de décrochage scolaire. « Les mesures de prévention de l’itinérance sont absentes des écoles, on doit y faire une entrée importante, car c’est une voie prioritaire pour rompre le cercle vicieux entre l’itinérance et le désengagement scolaire », souligne la chercheuse. L’école doit également adapter ses méthodes pour mieux répondre à la diversité des profils des élèves et combattre l’intimidation, un phénomène qui touche 83 %2 des jeunes, selon une étude canadienne.
Au-delà des liens fragilisés, une autre crise se présente, plus existentielle, qui se traduit par une perte de sens. Des jeunes expriment une vision pessimiste de l’avenir, renforcée par les crises sociales et environnementales actuelles.
« Il était frappant d’entendre autant de jeunes dire qu’ils ne voyaient pas d’avenir et se demander pourquoi s’investir dans une société qui les rejette », rapporte Sue-Ann MacDonald. Ce désenchantement touche aussi les intervenant.e.s, qui peinent à raviver l’espoir face à des inquiétudes si profondes. Dans ce contexte, il devient essentiel d’offrir aux jeunes des espaces où expérimenter et développer leur autonomie sont possibles. À défaut, la rue se présente parfois comme un terrain d’apprentissage où, malgré les contraintes, plusieurs y trouvent une forme de liberté et un sentiment de contrôle sur leur vie.
Cette recherche met également en lumière une crise de citoyenneté. Plusieurs jeunes disent ne pas
être entendus ni inclus dans la société. Ils déplorent l’absence de lieux où exprimer leurs préoccupations et participer aux décisions qui les concernent. « Les jeunes rencontrés se sentent souvent mal compris.
Il est important d’avoir des pratiques d’accompagnement plutôt que de direction pour répondre à leurs besoins comme à leurs aspirations », soutient la chercheuse.
Ce projet ne se limite pas à des recommandations : il s’incarne dans une démarche concrète. En s’appuyant sur la Coalition Jeunes+ et en rendant ses résultats accessibles par une exposition immersive de même que des balados, il fait bien plus que sensibiliser. Il engage le dialogue et appelle à l’action axée sur la responsabilité collective, pour penser et panser les ruptures sociales. Une belle façon de transformer les constats en leviers de changement et d’adapter les pratiques aux besoins réels des jeunes.
- Goyette, M. et collab. (2022). « Itinérance, judiciarisation et marginalisation des jeunes explacés au Québec », Chaire de recherche sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables. p. 5. ↩︎
- Gaetz, S. et collab. (2016). Without a Home : The National Youth Homelessness Survey.
Canadian Observatory on Homelessness Press, p. 10. ↩︎