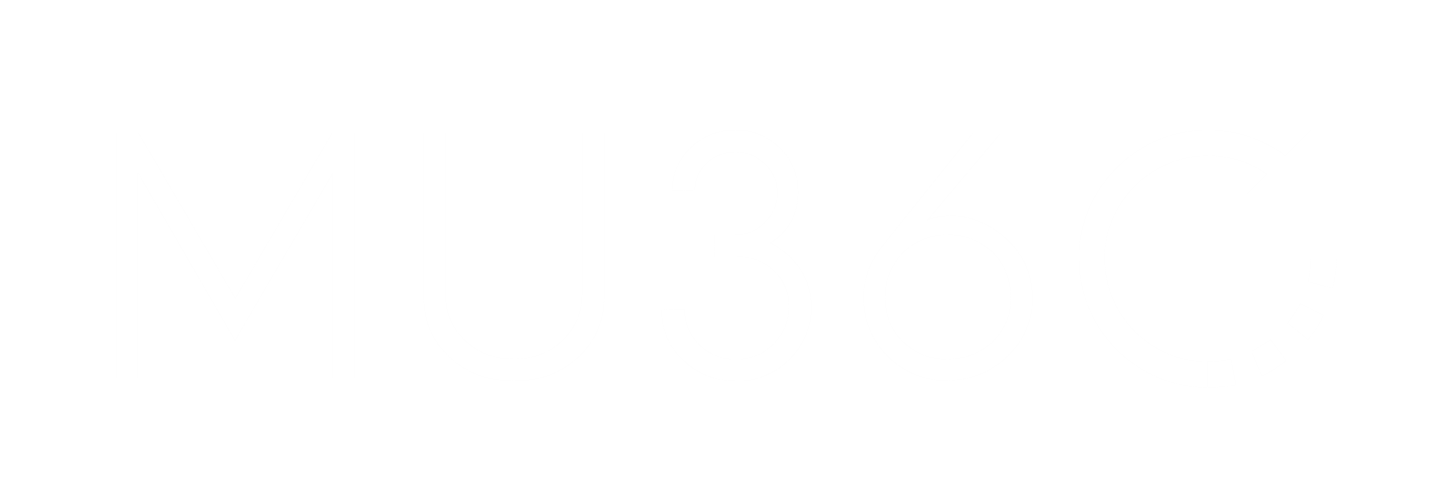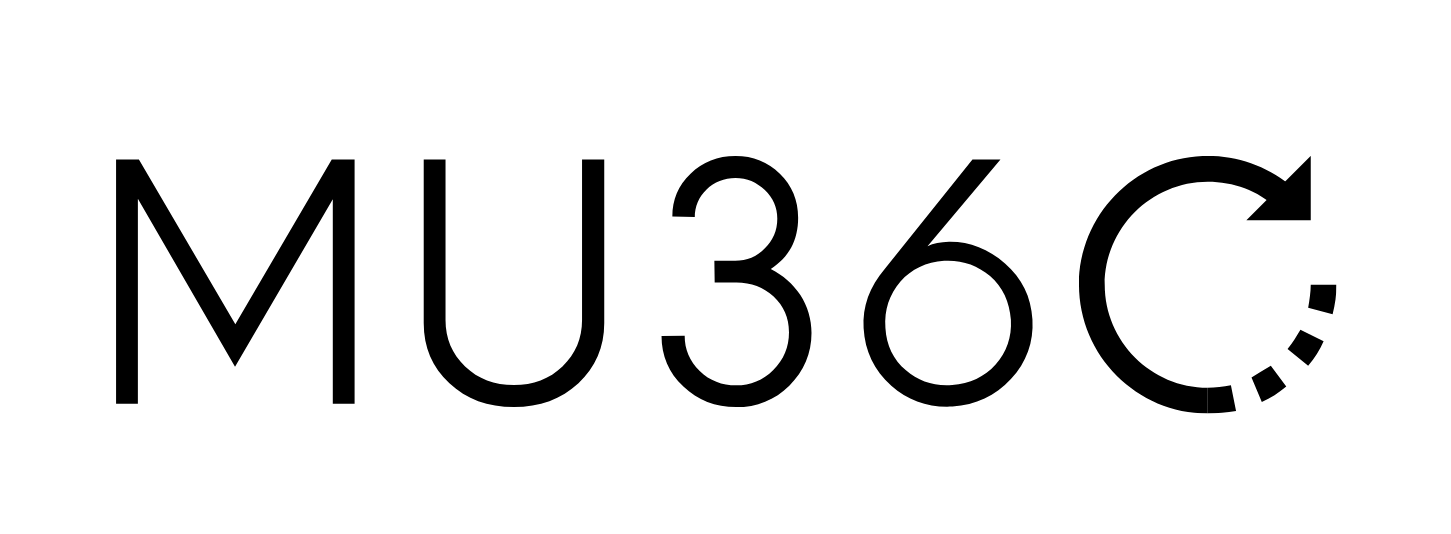À 18 ans, de nombreux jeunes quittent la protection de la jeunesse sans filet de sécurité. Livrés à eux-mêmes, ils doivent affronter les défis de la vie adulte. Pour les soutenir dans cette transition, le programme de Développement des apprentissages à la vie adulte (DAVA), du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, leur offre un accompagnement sur mesure pour développer leur autonomie et renforcer leur pouvoir d’agir.
DAVA ne suit pas un cadre rigide, laissant aux jeunes hommes qui y participent davantage de liberté pour façonner leur parcours. Le programme leur apprend avant tout à prendre des décisions éclairées, puis à organiser concrètement leur quotidien : trouver un logement, décrocher un emploi, gérer un budget et tisser un réseau social.
« Chaque jeune doit créer son horaire. Petit à petit, nous retirons les services qui ne leur seront pas disponibles dans le futur. Par exemple, au lieu d’aller à la cafétéria, ils reçoivent un montant hebdomadaire pour faire leur épicerie et préparer eux-mêmes leurs repas. Cuisiner sept jours sur sept, c’est un apprentissage majeur », explique Julie Cayouette-Bourassa, cheffe de service du programme DAVA.
Cette approche immersive permet aux participants d’expérimenter la réalité adulte dans un environnement sécurisant. « On leur donne un cadre où ils peuvent explorer et apprendre, sans risquer de tout perdre », ajoute Thomas Bazzarelli, spécialiste en activités cliniques.
Prévenir l’itinérance

Bien que son objectif premier ne soit pas de prévenir l’itinérance, DAVA tient compte de cette problématique et outille les jeunes pour y faire face. « Avant de prendre part au programme, ils ont été exposés à de nombreuses références. Chez nous, ils ont plus d’occasions d’être accompagnés pour expérimenter et explorer les ressources à leur disposition », explique Thomas Bazzarelli.
Ce soutien est d’autant plus crucial pour éviter des situations précaires comme l’itinérance cachée. « Certains sont hébergés temporairement chez des amis, mais pour les jeunes issus des centres jeunesse, l’itinérance peut devenir cyclique. Ils perdent leur logement, doivent quitter une colocation qui ne fonctionne plus, puis trouvent un autre endroit provisoire. Cette instabilité peut s’étendre sur plusieurs mois, surtout si des enjeux de santé mentale ou de consommation s’ajoutent », explique Pascal Jobin, chargé de projet au Centre d’expertise de l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD).
Impact réel
Pour mesurer son impact, une évaluation de programme est menée par l’équipe de recherche de l’IUJD. Sophie T. Hébert, chercheuse d’établissement et responsable de la modélisation du programme, présente ainsi la démarche : « On ne se concentre pas sur les comportements problématiques, car ce n’est pas l’objectif de DAVA. On évalue plutôt l’autonomie, le bien-être et le sentiment de contrôle des jeunes sur leur vie pour se coller davantage sur sa mission. »
Les jeunes sont rencontrés par l’équipe de recherche à trois moments clés : à leur entrée, peu avant leur sortie, puis six mois après. « Nous mesurons leur autonomie, leur réseau social, les traumatismes vécus et nous dressons une cartographie des effets perçus par les jeunes sortis du programme », ajoute la chercheuse.
Pour Julie Cayouette-Bourassa, cette collaboration avec la recherche est précieuse : « Avoir un regard extérieur sur notre travail, c’est rare. Cela nous offre l’occasion de nous autoévaluer, de nous remettre en question et d’améliorer constamment nos pratiques. »
Les effets de cette coopération sont tangibles. Grâce à des outils concrets, ces jeunes renforcent leur confiance en eux, trouvent un meilleur équilibre et brisent l’isolement, ce qui leur permet d’éviter des parcours instables.
Un modèle inspirant
Le succès de DAVA dépasse désormais ses murs et suscite un intérêt croissant, tant au Québec qu’à l’étranger. Plusieurs CISSS, CIUSSS et organismes communautaires cherchent à l’adapter à leurs réalités, tandis qu’il attire l’attention d’établissements au Chili et en France, inspirant des initiatives similaires.
« D’autres milieux nous interpellent pour obtenir des ateliers sur le développement du pouvoir d’agir. Il y a une réelle volonté de comprendre cette approche », souligne Sophie T. Hébert.
DAVA s’impose peu à peu comme un modèle à suivre. Et si son approche devenait la norme plutôt que l’exception?
Foyer 1re Avenue : une vision commune pour l’autonomie des jeunes
L’IUJD se positionne comme un acteur clé dans l’amélioration des pratiques visant l’accompagnement des jeunes issus des centres jeunesse1 vers l’autonomie. En plus du programme DAVA, qui soutient les jeunes hommes, l’équipe met également son expertise au service du Foyer 1ʳᵉ Avenue qui accompagne les jeunes femmes dans cette transition essentielle.
Tout comme le programme DAVA, le Foyer 1re Avenue est conçu pour combler le vide entre le milieu institutionnel et la vie adulte. « La marche à monter à 18 ans est tellement haute, illustre Stéfanie Trépanier, cheffe de service au Foyer 1re Avenue. On fait le pari d’être le tampon entre les deux. »
Pour y parvenir, le programme repose sur une approche progressive. Les adolescentes amorcent leur parcours dans un environnement collectif structuré avant d’accéder à un loft qui reproduit les conditions d’un appartement autonome.

Optimiser les pratiques
L’IUJD ne se limite pas à soutenir ces initiatives, il les renforce par la recherche. « L’idée, c’est de pouvoir apporter des éléments de réponse aux questions que se posent les équipes sur le terrain, explique Laurence Magnan-Tremblay, doctorante en psychoéducation impliquée dans le projet. Dans le cadre de mes études, j’ai beaucoup lu sur les défis que ces jeunes vivent. Je peux faire bénéficier les gens des connaissances acquises au fil de mes recherches. »
Cette démarche s’appuie sur une approche collaborative où l’expérience des personnes est au cœur du processus. « Le but, c’est vraiment de travailler ensemble pour améliorer les pratiques destinées aux jeunes femmes qui passent par le loft », précise Charline Côté, chargée de projet clinico-scientifique à l’IUJD. Ceci se fait en plusieurs étapes : d’abord, par des entrevues individuelles pour mieux comprendre leur vécu, puis par des ateliers où jeunes, intervenant.e.s et équipe de recherche croisent leurs expertises afin de concevoir la version idéale du loft.
Ce partage de savoirs va au-delà de la recherche. Il se traduit également par des échanges entre les différentes initiatives. L’équipe du Foyer 1ʳᵉ Avenue a d’ailleurs sollicité celle de DAVA pour obtenir une formation, illustrant l’importance du transfert de connaissances entre ces programmes complémentaires.
Prendre son envol
À 18 ans, l’heure du départ sonne. Entre la théorie et la réalité, le fossé est grand. En plus de devoir quitter le Foyer, ces jeunes femmes se heurtent au double défi du manque de ressources et de la difficulté à trouver un logement abordable.
Si certaines partent confiantes, d’autres hésitent. La transition vers l’autonomie semble intimidante après un parcours marqué par l’instabilité. Mais quand elles y arrivent, le changement est frappant.
Grâce à l’accompagnement de l’IUJD et à l’engagement des équipes, ces jeunes femmes ne quittent pas seulement un foyer, elles prennent leur envol vers leur « vraie vie ». Elles s’approprient enfin un espace qui leur appartient, prennent des décisions pour elles-mêmes et, surtout, réalisent qu’elles peuvent voler de leurs propres ailes.
Aux yeux de Suzie Bourbonnais, spécialiste en activités cliniques au Foyer 1re Avenue, voir ces jeunes tracer leur route après tant d’épreuves, c’est la plus belle des victoires.
LES DÉTAILS…
Pour en savoir plus : Benaguida, A., Descary, G., Hébert Sophie T., Gueye, O., Miller, A., et Bazzarelli, T. (2022). La transition à la vie adulte en contexte de protection : point de vue des acteurs communautaires et institutionnels – Bulletin d’information, no 13. Montréal, IUJD, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
- Ceci est le nom couramment utilisé, mais le nom officiel est Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation. ↩︎