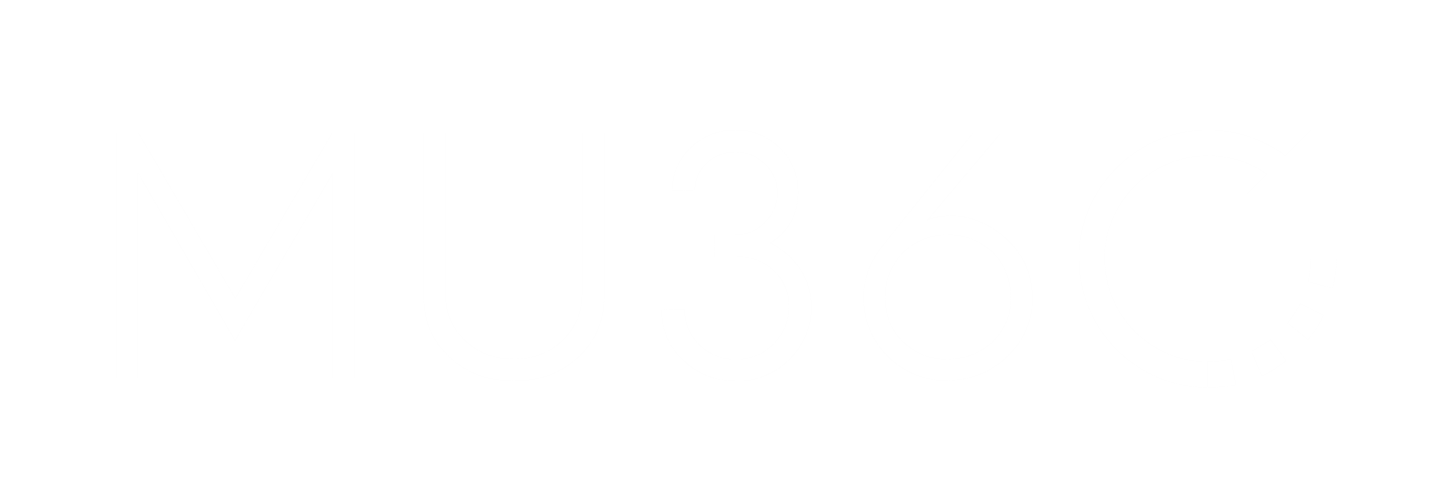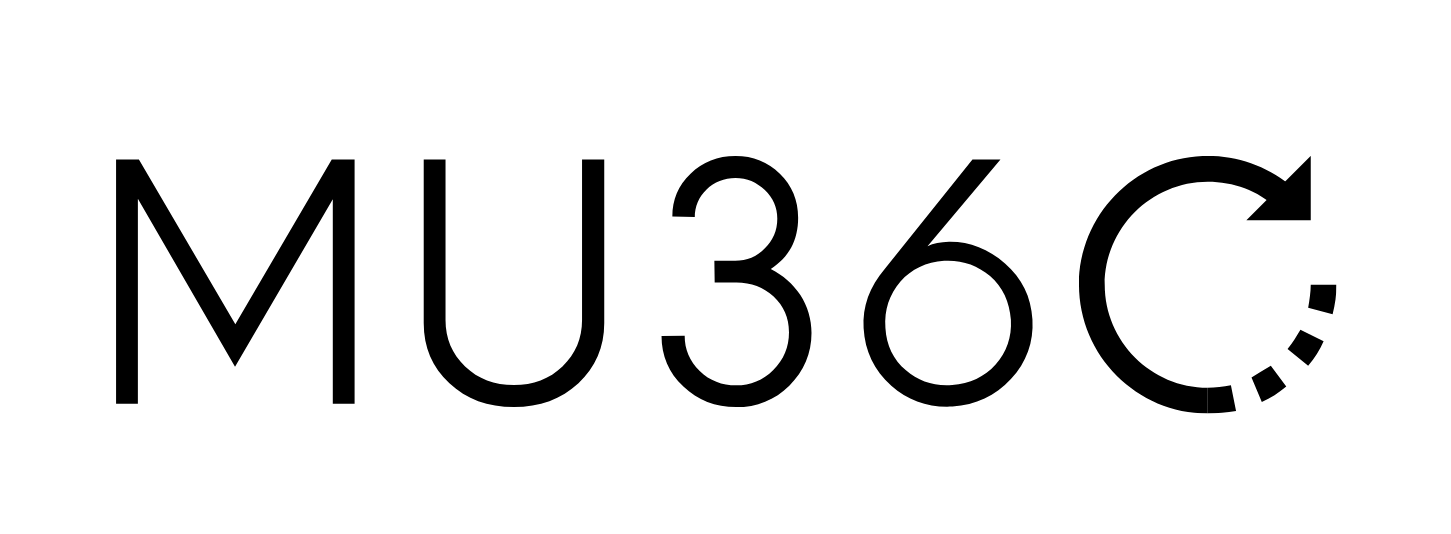Trop souvent, l’itinérance est perçue à travers son aspect le plus apparent, alors que la forme cachée est nettement plus répandue. Le dernier rapport de dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible estime que sa forme cachée touche 7 % de la population québécoise, contre 1 % pour la forme visible1. Les gens qui passent d’un lieu de vie à un autre, en dormant temporairement chez des proches ou dans des logements de transition, vivent une précarité, loin des regards.
La crise actuelle de l’itinérance dépasse largement la pénurie de logements. C’est une crise de droits humains et sanitaire majeure, révélatrice de la manière dont notre société accueille et traite les personnes en situation de grande précarité. Tout le monde doit se sentir concerné par celle-ci, car derrière chaque statistique se trouve un être humain avec une histoire, des espoirs et un besoin fondamental d’être reconnu.
Plusieurs stratégies s’imposent
Une approche globale et concertée devient urgente. Il faut mobiliser toutes les équipes et explorer de nouveaux leviers d’action. Chaque direction, au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) comme dans l’ensemble du réseau de la santé, doit accueillir, soigner et guider les personnes en situation d’itinérance, de tout âge, selon la Stratégie d’accès aux services de santé et aux services sociaux pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir (2018).
Le financement en itinérance devrait être repensé. Le modèle actuel, principalement basé sur des appels à projets annuels, fragilise la stabilité financière des organismes communautaires. Il leur devient ainsi difficile de planifier à long terme, de retenir leurs employé.e.s et d’assurer un accompagnement constant des personnes en situation de vulnérabilité. Un budget récurrent et durable permettrait d’obtenir un meilleur impact des actions.
La coordination des services est tout aussi essentielle. À Montréal, plusieurs initiatives de concertation, réunissant des acteurs et actrices de tous les milieux, favorisent une réponse cohérente. Ces lieux gagnent à être investis, en impliquant notamment des personnes concernées et en reconnaissant leurs expertises, pour s’attaquer de manière intersectorielle aux causes de l’itinérance.
Il faut élargir l’accès aux services de santé pour rejoindre davantage de personnes à risque et intervenir en amont. Celles qui sont en situation de grande précarité passent souvent entre les mailles du filet ou se heurtent à des portes closes, faute de repérage précoce ou d’un accès facilité aux services qui leur sont pourtant destinés. En évaluant systématiquement la stabilité résidentielle, dans l’ensemble des services, on pourrait mieux détecter les signes de précarité.
L’itinérance n’est pas une fatalité, mais elle demeure une réalité pour laquelle nous sommes peu outillés, bien que ce phénomène, d’une ampleur alarmante, soit connu et documenté. Elle peut être freinée en soutenant mieux les transitions de vie (sortie des centres jeunesse et des unités psychiatriques, dépendance, perte d’emploi, parcours migratoire, etc.), en adaptant les politiques de prévention et en misant sur une diversité de modèles d’intervention et d’espaces de vie.
Mobilisation collective
Ce numéro vise à élargir la perspective en explorant les zones de fragilité liées aux transitions de vie et en abordant des aspects méconnus de l’itinérance. Il montre aussi l’indispensable collaboration entre les équipes de soins et celles de la recherche du CCSMTL pour mettre en place des initiatives audacieuses qui produisent des résultats concrets. Le programme de gestion de la consommation de l’alcool de Projets autochtones du Québec, par exemple, montre bien la pertinence de sortir des sentiers battus. C’est en unissant nos expertises que nous parviendrons à mieux comprendre et prévenir l’itinérance.
La crise exige une forte volonté de changement, des actions concertées, une recherche engagée et une société prête à imaginer de nouvelles solutions. Il est temps d’en faire une priorité collective.
Bonne lecture!

Vicky Kaseka
Corédactrice en chef invitée
Directrice des Programmes santé mentale et dépendance, CCSMTL

Pierre Pariseau-Legault
Corédacteur en chef invité
Codirecteur scientifique du CREMIS
- L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2020-2021 l’estimait à 4,2 %. « Ces sources permettent de mesurer de manière fiable l’ampleur réelle de l’itinérance cachée, qui demeure – il est
essentiel de le souligner – plus vaste que l’itinérance visible.», voir Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2023). Dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible au Québec.
Rapport de l’exercice du 11 octobre 2022, p. 15. ↩︎